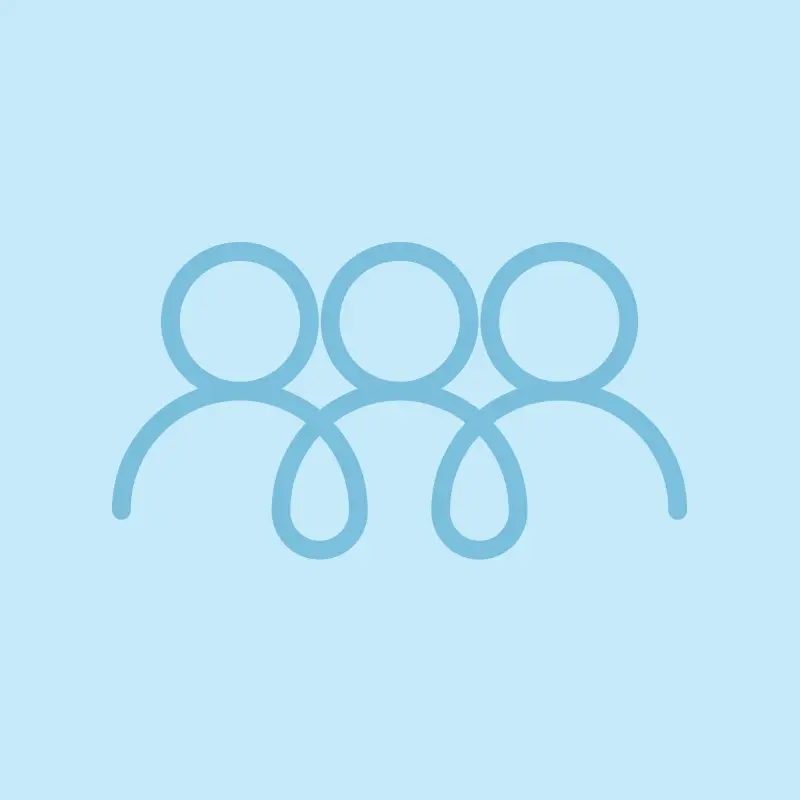En apprendre plus sur la déficience intellectuelle
La déficience intellectuelle (DI) est de plus en plus connue. Par contre, il reste quand même plusieurs défis à relever pour que les personnes ayant une DI prennent pleinement leur place dans la société.Les personnes ayant une DI, avec leurs particularités individuelles, ont de grandes aptitudes et peuvent se démarquer, si on leur en donne la possibilité et les outils adaptés à leurs besoins spécifiques.
Sur cette page
Pour s’unir pour un Québec inclusif, il faut comprendre la déficience intellectuelle et ses enjeux.
La SQDI et ses membres sont actuellement en période de consultations pour préciser les différents enjeux listés ci-dessous.

Comprendre la déficience intellectuelle
Définition
La déficience intellectuelle (DI) est un état permanent qui survient avant l’âge de 18 ans.
Ce n’est pas une maladie.
Elle est présente pour toute la vie de la personne.
La déficience intellectuelle peut coexister avec d’autres états, tels que :
- l’autisme
- l’épilepsie
- un TDAH
- une situation de handicap physique
- des difficultés psychologiques
- des incapacités sensorielles
- des problèmes de santé physique
- etc.
La personne « a une déficience intellectuelle » ou « vit avec une déficience intellectuelle ».
Elle n’est pas « atteinte de déficience intellectuelle » et ne « souffre » pas de sa déficience intellectuelle.
Impacts sur la vie quotidienne
Difficultés
Ces personnes peuvent rencontrer des difficultés dans un ou plusieurs de ces domaines :
- Retenir plusieurs informations à la fois
- Maintenir et généraliser des nouveaux apprentissages
- Comprendre les notions abstraites (exemple : argent, infraction pénale)
- Faire des liens logiques
- Planifier
- Résoudre des problèmes
- Maîtriser suffisamment le langage oral, écrit, et le calcul
- Se repérer dans le temps et l’espace
- Se concentrer
- Avoir une bonne conscience du danger
- Comprendre les normes sociales et leurs nuances
Cette liste n’est pas complète.
Habiletés adaptatives
Définition des habiletés adaptatives sont la possibilité pour la personne de fonctionner dans son quotidien de façon autonome comparativement aux personnes du même âge et dans le même contexte.
Exemples d’habiletés adaptatives : gérer ses repas, son logement, son transport, ses finances, sa sécurité, son travail, sa vie sociale, etc.
Définition de capacitisme : Ensemble d’attitudes négatives qui disent qu’une personne en situation de handicap serait moins digne d’être traitée avec respect et égard, moins apte à contribuer et à participer à la société ou moins importante intrinsèquement que les autres.
Ces attitudes peuvent restreindre les possibilités offertes aux personnes handicapées et réduire leur participation à la vie de leur collectivité.

Les personnes concernées
Au Québec, entre 1 % et 3 % de la population vit avec une déficience intellectuelle. Cela représente plusieurs milliers de personnes, chacune avec son propre parcours.
Mais la déficience intellectuelle concerne aussi leurs familles, leurs proches et les personnes qui les entourent. Comprendre cette réalité aide à mieux répondre aux besoins, à soutenir les proches et à bâtir une société plus inclusive.
Les personnes ayant une déficience intellectuelle
Bien que 1 % et 3 % de la population au Québec vit avec une déficience intellectuelle, il est cependant difficile de connaître le nombre exact de personnes concernées.
Plusieurs raisons expliquent cette situation, notamment l’environnement culturel, l’absence de diagnostic chez certaines personnes ou encore le fait que d’autres passent inaperçues dans le système et ne reçoivent pas les services adaptés à leurs besoins.
La déficience intellectuelle peut avoir différentes causes. Elle peut être liée à des facteurs génétiques, comme la trisomie 21, ou à des facteurs environnementaux, comme des complications pendant la grossesse ou l’accouchement, une infection grave ou un manque d’oxygène à la naissance. Toutefois, dans de nombreux cas, la cause exacte reste inconnue.
Il existe différents degrés de déficience intellectuelle, qui varient selon les capacités d’apprentissage et d’autonomie de chaque personne :
- Légère : La personne peut apprendre et développer son autonomie avec du soutien.
- Modérée: Elle a besoin d’accompagnement dans plusieurs aspects de sa vie quotidienne.
- Sévère : Elle nécessite un soutien constant pour ses besoins quotidiens.
- Profonde : Elle a besoin d’un accompagnement spécialisé en tout temps.
Chaque personne avec une déficience intellectuelle a son propre parcours et ses propres forces. Avec un bon accompagnement, elle peut développer ses compétences et participer pleinement à la société.
Pauvreté
- Au Canada, 75 % des adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) sont en situation de pauvreté.
- Le revenu moyen des personnes d’âge actif ayant une DI est inférieur à la moitié de celui des Canadiens sans déficience intellectuelle.
- Près de la moitié des personnes d’âge actif ayant une DI dépendent de l’aide sociale provinciale/territoriale comme principale source de revenu.
- Taux d’emploi est plus faible chez les personnes ayant une DI
- Les personnes avec une DI sont moins incluses dans la société
Abus
Intersectionnalité : Le risque de violence augmente encore lorsque les personnes sont situées à des intersections, telles que :
- Être une femme et avoir une DI
- Être immigrant et avoir une DI
- Être autochtone et avoir une DI
- Être issu de la communauté LGBTQ+ et avoir une DI
- etc
Des problèmes peuvent survenir dans certains lieux d’hébergement ou avec certains proches, y compris différentes formes d’abus.
Les parents et les personnes proches aidantes
Les parents et les proches jouent un rôle essentiel dans la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle en les accompagnant au quotidien.
Cependant, ils font face à de nombreux défis, comme l’accès aux services, la conciliation travail-famille et la charge mentale et émotionnelle.
Heureusement, des ressources et du soutien existent pour les aider, comme des services d’accompagnement et des groupes de soutien. Il est aussi important de reconnaître leur engagement et de leur offrir des moments de répit pour éviter l’épuisement.

La déficience intellectuelle tout au long de la vie
La naissance et la petite enfance
L’annonce de diagnostic
Lorsque le parent apprend à la naissance le diagnostic d’un enfant vivant avec une trisomie, une déficience intellectuelle peut déjà être repérée.
À ce moment-là, les professionnels du réseau de la santé doivent offrir des ressources aux parents pour répondre aux différents besoins à venir.
Lorsque la déficience intellectuelle n’est pas diagnostiquée à la naissance, il est important pour le parent qui remarque un retard de développement global chez l’enfant de prendre contact rapidement avec l’organisme local le plus près de chez lui ainsi qu’avec le réseau de la santé.
L’importance de la stimulation précoce
Donner naissance à un enfant est une expérience formidable et remplie de promesses. Tous les espoirs sont alors permis… Mais cette naissance comporte également son lot d’angoisses, d’inquiétudes et de remises en question. Serai-je à la hauteur de cette responsabilité? Aurai-je la force et les compétences afin de maintenir le cap pour les vingt prochaines années?
Ces questions, tous les parents se les posent, mais elles ont un poids différent lorsque ces derniers mettent au monde un enfant présentant une déficience intellectuelle. Une fois l’onde de choc de l’annonce du diagnostic passée, plusieurs étapes restent à surmonter avant l’acceptation de l’état de cet enfant. Si l’on en croit le témoignage de nombreux parents, ce chemin de Damas est nettement facilité par des interventions précoces de qualité, réalisées auprès de l’enfant et de sa famille.
Depuis plusieurs années, on entend de la part des parents de réelles préoccupations quant à l’intervention précoce. Alimentées par les nombreux changements vécus dernièrement dans le réseau de la santé et des services sociaux, ces préoccupations touchent particulièrement l’offre de services proposée par les centres de réadaptation, tant sur le plan de l’accessibilité, de la qualité, de la quantité que de la pérennité.
Au cours des années 2000, on observe un changement important en ce qui concerne l’offre de services des organismes publics aux nouvelles familles (enfants de 0 à 5 ans). Auparavant, les approches étaient axées autour de la stimulation précoce. Un programme individualisé était mis en place afin de favoriser la progression de l’enfant dans toutes les sphères de son développement. Depuis une dizaine d’années et à la suite des compressions budgétaires dans le réseau de la santé et des services sociaux, les centres de réadaptation proposent plutôt une approche globale, dirigée vers l’enfant mais également vers la famille et son environnement. C’est ce qu’on appelle l’intervention précoce.
Toutefois, avec ce changement important, l’offre de service individualisée en stimulation précoce a considérablement diminué. Cette baisse a eu des répercussions importantes pour les parents. En effet, en plus de devoir composer avec leur nouvelle réalité familiale, ils sont contraints d’entreprendre de nombreuses démarches afin d’obtenir des services professionnels favorisant le développement de leur enfant. Par ailleurs, on remarque malheureusement une très grande disparité dans l’offre de services des centres de réadaptation selon les régions.
Les longues listes d’attente, les restructurations nombreuses ainsi que la mouvance du personnel sont des éléments très souvent mentionnés par les parents.
Le Guide Portage : de la naissance à six ans propose un outil d’observation du développement et plusieurs stratégies qui visent à stimuler le développement de l’enfant de la naissance à six ans.
Le guide a été principalement conçu pour des interventions à domicile et comprend plusieurs stratégies de stimulation pouvant être réalisées auprès de l’enfant dans son milieu familial. Le choix des activités proposées tient compte de son niveau de développement, et ce, dans les différentes sphères. Le guide est très centré sur les activités de la vie courante et sur les interactions entre l’enfant et les autres membres de sa famille.
L’inclusion scolaire
Pour la SQDI, en conformité avec les chartes, lois et politiques éducatives, il faut dans un premier temps envisager d’accueillir tout élève dans une classe régulière de son école de quartier, avec les élèves de son groupe d’âge pour qu’il y reçoive des services éducatifs.
Si une personne a des besoins particuliers, il doit avoir accès à un programme adapté lui permettant de développer des apprentissages, de même que son autonomie, en visant une réelle participation sociale.
Ainsi, avant même son entrée en classe de l’élève ayant une déficience intellectuelle, on doit procéder à une évaluation dans le but de déterminer ses besoins et l’étendue de ses capacités. Cette évaluation, adaptée aux besoins de l’enfant, sert à établir le plan d’intervention individualisé, lequel détermine les objectifs visés pour la réussite de l’élève et les moyens d’y parvenir, ce qui inclut des services et outils adaptés et un soutien au professeur lorsque requis.
L’élève est évalué par rapport à lui-même et aux objectifs académiques et sociaux prévus à son plan d’intervention et non en comparaison aux autres élèves. Ce plan est réévalué fréquemment. Enfin, l’élève bénéficie d’un relevé de compétences attestant ses acquis.
De plus, le milieu scolaire se doit de reconnaître l’expertise parentale et d’impliquer les parents lors de tout processus décisionnel, notamment lors de l’élaboration du plan d’intervention. On se doit également de leur communiquer toute l’information pertinente pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées tant pour leur enfant que lors de leur participation à des comités scolaires.
Enfin, le parent qui le désire doit pouvoir se faire accompagner, dans le dossier de son enfant, par la personne de son choix.
Loisirs
Les loisirs, tout comme les activités culturelles ou de tourisme, sont des façons de participer à la vie sociale. Comme bien des gens, certaines personnes ayant une déficience intellectuelle nécessitent l’aide d’une personne pour les accompagner dans ces activités.
Dans un ensemble d’établissements participants, la personne accompagnatrice n’aura pas à défrayer les coûts d’entrée grâce à la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir. Cette vignette reconnaît le droit à un accompagnement gratuit à la personne.
Développement des compétences de base
Développer les compétences de base dès l’enfance : une étape essentielle
Les compétences de base
Les compétences de base sont les choses qu’un enfant apprend pour bien grandir.
Par exemple :
- Reconnaître ses émotions
- Communiquer avec les autres
- Comprendre ce qu’on lui dit
- Se déplacer
- S’habiller
- Manger seul
Ces compétences aident les enfants à être plus autonomes et à participer à la vie autour d’eux.
Pourquoi c’est important dès l’enfance
Les premières années de la vie sont très importantes pour le développement. C’est à ce moment que le cerveau apprend le plus vite.
Si on accompagne bien un enfant dès le début, il peut apprendre plus facilement et développer son plein potentiel.
Pour un enfant ayant une déficience intellectuelle, cela veut dire :
- recevoir du soutien adapté à ses besoins
- apprendre à son rythme
- être encouragé dans ses réussites
Un impact pour toute la vie
Quand un enfant apprend les compétences de base tôt, il est mieux préparé pour :
- aller à l’école
- se faire des amis
- prendre soin de lui
- vivre plus autonome en grandissant
C’est aussi une façon de renforcer sa confiance et de mieux le préparer pour l’avenir.
Soutenir les familles et les milieux éducatifs
Les parents, les éducateurs et les professionnels jouent un rôle essentiel.
Ils ont besoin d’outils, de temps et de formation pour bien accompagner les enfants.
L’adolescence et le début de la vie adulte
Transition de l’école à la vie active (TEVA)
La transition de l’école vers la vie active, aussi appelée TEVA, est une étape très importante dans la vie des jeunes.
Elle concerne surtout les jeunes qui fréquentent l’école secondaire et qui ont :
- une déficience intellectuelle
- une incapacité significative et persistante
- ou de grandes difficultés d’adaptation ou d’apprentissage
Ces jeunes doivent être bien accompagnés pour se préparer à la vie adulte.
Une démarche qui peut aussi commencer ailleurs
Certains jeunes continuent leurs études à l’éducation des adultes ou en formation professionnelle.
Eux aussi peuvent bénéficier d’une démarche TEVA.
Une réussite qui passe par le travail d’équipe
Pour que la TEVA fonctionne bien, il est essentiel que tous les partenaires travaillent ensemble, incluant :
- l’école
- la famille
- les intervenants du milieu de la santé et des services sociaux
- les organismes communautaires
- les milieux de travail
Quand tout le monde collabore, cela aide la ou le jeune à bâtir un projet de vie solide, à son rythme, selon ses forces et ses choix.
Vie amoureuse et vie intime
Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont, comme tout le monde, des désirs, des sentiments et des besoins affectifs.
Elles peuvent vouloir :
- avoir un amoureux ou une amoureuse
- vivre une relation amoureuse
- explorer leur sexualité
- fonder une famille
Malheureusement, la vie amoureuse et la vie intime sont souvent des sujets mis de côté ou tabous.
Certaines personnes croient, à tort, que les personnes ayant une déficience intellectuelle ne peuvent pas vivre ce type de relation.
Cela peut mener à :
- de la surprotection
- du jugement
- un manque d’information et d’éducation
- des droits non respectés
Des besoins réels et importants
Pour vivre une vie amoureuse et intime en sécurité et dans le respect, les personnes doivent avoir accès à :
- de l’information claire et adaptée
- un espace pour parler de leurs émotions, de leurs envies et de leurs limites
- un accompagnement bienveillant, sans infantilisation
- une éducation à la sexualité accessible, dès l’adolescence
Respecter leur droit de choisir
Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont le droit :
- d’aimer et d’être aimées
- de faire leurs propres choix
- de vivre des relations libres et consenties
- d’être protégées contre les abus et la violence
Accompagner les personnes dans leur vie affective et sexuelle, c’est respecter leur dignité et leur droit à une vie pleine et épanouie.
Parentalité
Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont, comme tout le monde, le droit de vouloir avoir des enfants.
Certaines deviennent parents et veulent s’occuper de leur enfant avec amour et responsabilité.
Des préjugés encore présents
Malheureusement, ce désir est souvent mal compris.
Il existe plusieurs préjugés dans la société, par exemple :
- On pense qu’une personne ayant une déficience intellectuelle ne peut pas être un « bon parent »
- On doute de sa capacité à répondre aux besoins d’un enfant
- On veut parfois lui enlever la garde sans lui donner de soutien
Ces jugements peuvent créer beaucoup de stress, de peur et d’isolement.
Le besoin de soutien adapté
Être parent est un défi pour tout le monde.
Les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent très bien y arriver avec du soutien adapté à leurs besoins, comme :
- de l’accompagnement à la maison
- des services en périnatalité adaptés
- du soutien à la planification et à l’organisation du quotidien
- une approche respectueuse et non jugeante des intervenants
Ce soutien doit être préventif, continu et centré sur les forces des parents.
Respecter le droit à la parentalité
Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont le droit :
- de faire des choix en matière de sexualité et de parentalité
- d’avoir accès à de l’information claire sur la grossesse, la contraception et l’éducation des enfants
- d’être écoutées et soutenues dans leur rôle de parent
- de ne pas être discriminées à cause de leur déficience
Avoir une déficience intellectuelle ne devrait jamais empêcher une personne d’être parent, si elle le souhaite et si elle est bien accompagnée.
La vie d’adulte (21 ans et +)
L’inclusion en emploi
Pour la SQDI, toute personne doit avoir la possibilité d’exercer une activité de travail, dans la mesure de ses capacités, dans un environnement inclusif et sécuritaire. Comme tout le monde, les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent exercer des activités de travail de différentes façons :
Les emplois réguliers ou adaptés (pour les personnes prêtes à l’emploi)
- Un emploi rémunéré à salaire (assujetti aux normes du travail), sans subvention ou avec, par exemple, un contrat d’intégration au travail (CIT)
- Un emploi rémunéré à salaire (assujetti aux normes du travail), en entreprise adaptée
- Un travail autonome
Les programmes et mesures d’Emploi-Québec (Pour les personnes éloignées du marché du travail)
- Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS Action, PAAS Réussir)
Les personnes participant à ces programmes ne reçoivent pas de salaire, mais elles reçoivent une allocation de soutien à la participation de 130 $ par mois qui s’ajoute à leur prestation de solidarité sociale.
Les activités socioprofessionnelles et communautaires (pour les personnes très éloignées du marché du travail)
- Ateliers de travail ou plateaux de travail
- Stages en entreprises ou en milieu communautaire
Pour ces types d’activités, les personnes effectuent certaines tâches à leur rythme et avec encadrement. Elles ne sont pas rémunérées. Dans certaines régions, lorsqu’une entente subsiste avec le Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS), elles peuvent recevoir une allocation de fréquentation (moins de 5 $ par jour) sans que celle-ci ne soit déduite de leur chèque de solidarité sociale.
- Activités de jour
Il ne s’agit pas ici d’activités de travail, mais d’intégration communautaire, artistique, culturelle, éducative, sportive, bénévole ou autre.
Le rôle social actif
Le rôle social actif et la participation sociale sont des enjeux importants pour la SQDI et ses organisations membres.
Le rôle social actif est l’idée que les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent apporter beaucoup à la société, et pas seulement être aidées.
La participation sociale est le fait de pouvoir être inclus dans la société, sans obstacles et sans être discriminé, comme tout le monde.
Vieillir avec une déficience intellectuelle
Les défis du vieillissement
Les personnes ayant une déficience intellectuelle vivent plus longtemps qu’avant. C’est une bonne nouvelle! Cela veut dire que leur vie est de meilleure qualité et que les soins de santé sont meilleurs.
Mais en vieillissant, ces personnes peuvent avoir de nouveaux besoins. Leur santé peut changer. Elles peuvent avoir plus de fatigue, des douleurs, ou des pertes de mémoire.
Parfois, ces signes sont mal compris. On croit que c’est à cause de la déficience intellectuelle. Mais en réalité, ce sont des signes normaux du vieillissement. C’est ce qu’on appelle l’effet de masquage.
Si on ne remarque pas ces changements, la personne ne reçoit pas les bons soins ou le bon soutien.
Il est donc très important de :
- bien connaître les signes du vieillissement.
- former les proches, les intervenants et les professionnels.
- offrir des lieux de vie adaptés pour les personnes plus âgées.
- proposer des activités qu’elles aiment et du soutien chaque jour.
Vieillir avec respect et dignité, c’est un droit pour tout le monde.
Vieillir avec la trisomie 21
La Société canadienne de la trisomie 21 a réalisé un guide complet sur le vieillissement des personnes ayant la trisomie 21. Intitulé « Aujourd’hui et demain, un guide sur le vieillissement avec la trisomie 21 », le guide passe en revue différents aspects du vieillissement des personnes vivant la trisomie 21.
Le Projet ReVie
Au Québec, les personnes vieillissantes ayant une déficience intellectuelle vivent souvent des difficultés d’accès aux services, de transitions entre milieux de vie et de maintien d’habitudes de vie saines. Pour répondre à ces défis, en 2021, l’organisme Sans Oublier le Sourire et plusieurs partenaires ont initié la première phase du Projet ReVie en collaboration avec plusieurs partenaires.
La deuxième phase du Projet ReVie est pilotée par un nouveau comité porteur, composé de la Fédération québécoise de l’autisme, d’Élise Milot (professeure et chercheuse en travail social, Université de Laval), de Proche Aidance Québec et de la Société québécoise de la déficience intellectuelle.
Le nouveau comité porteur a été formé avec deux intentions principales :
- Promouvoir l’enjeu du vieillissement des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle à l’échelle provinciale;
- Mobiliser les connaissances et les expertises issues des réseaux de chacune des organisations afin de développer une compréhension commune des enjeux vécus par les personnes vieillissantes autistes et/ou avec une déficience intellectuelle.

Aides financières
Le gouvernement du Québec ainsi que le gouvernement du Canada apportent un soutien financier aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle et à leur famille, lorsqu’elles correspondent aux critères de personnes handicapées tels que définis par l’agent payeur.
Voici les principaux programmes qui pourraient leur être accessibles :
Pour les enfants
(moins de 18 ans)
Pour les adultes
(aides financières de dernier recours)

Encourager l’inclusion
Tout le monde a le droit de faire partie de la société. Les personnes ayant une déficience intellectuelle veulent, comme tout le monde, être respectées, entendues et avoir les mêmes chances.
Elles souhaitent, comme tout le monde :
- aller à l’école
- avoir un emploi
- participer à des activités
- vivre dans un endroit qu’elles aiment
- avoir des relations sociales
Des obstacles encore présents
Malheureusement, les personnes ayant une déficience intellectuelle sont encore souvent exclues.
Elles sont moins invitées, moins consultées et leurs capacités sont parfois sous-estimées.
Ces barrières les empêchent de participer pleinement à la vie de leur communauté.
L’inclusion est possible
Avec du soutien, les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent apprendre, travailler, faire des choix et contribuer à la société.
Pour favoriser l’inclusion, il est important de :
- écouter leurs besoins
- adapter la communication
- offrir des milieux accessibles et ouverts
- les accompagner sans les contrôler
Inclure, c’est aller plus loin
L’inclusion ne consiste pas seulement à accepter la différence. C’est inviter, valoriser et reconnaître la richesse que chaque personne apporte.
Inclure les personnes ayant une déficience intellectuelle, c’est construire une société plus juste, plus humaine et plus forte.